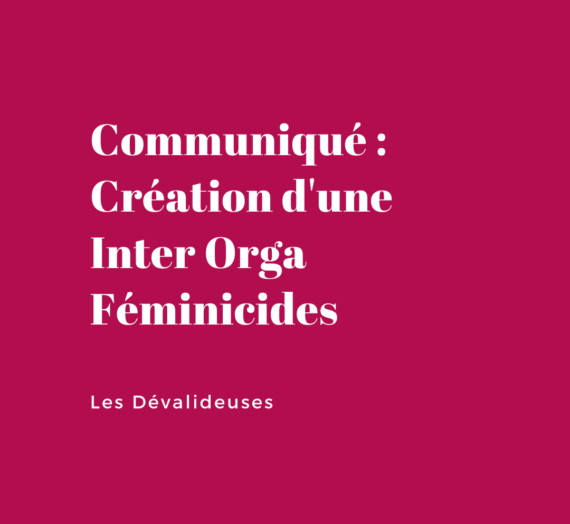En France, un nombre important d’enfants et d’adultes handicapEés vivent en institutions. Ces lieux sont dénoncés par les mouvements antivalidistes et par l’ONU[1]L’ONU face à l’institutionnalisation : Une violation des droits humains en raison de la privation de liberté qu’ils entraînent. L’infantilisation et la déshumanisation des personnes vivant en institution accroissent leur exposition aux violences sexistes et sexuelles. La lutte contre ces violences sexuelles nécessite une analyse au croisement du féminisme et de l’antivalidisme.
Les violences institutionnelles, c’est quoi ?
En France, les établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap se répartissent en plusieurs catégories. Voici les principaux types d’établissements, accompagnés des données disponibles concernant le nombre de personnes accueillies ou de places offertes :
Pour les enfants et adolescentEs :
- Instituts médico-éducatifs (IME) : accueillent des jeunes présentant une déficience intellectuelle.
- Instituts d’éducation motrice (IEM) : spécialisés dans l’accueil des jeunes avec des déficiences motrices.
- Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) : destinés aux jeunes ayant des troubles de la conduite et du comportement.
- Instituts d’éducation sensorielle : pour les jeunes présentant une déficience auditive et/ou visuelle.
- Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : assurent un accompagnement éducatif et thérapeutique en milieu ordinaire.
Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), fin 2018 (chiffres les plus récents), 167 300 enfants et adolescentEs étaient accompagnéEs dans ces établissements et services médico-sociaux, représentant 1 % de l’ensemble des moins de vingt ans en France.
Pour les adultes :
- Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) : offrent une activité professionnelle adaptée et un soutien médico-social.
- Foyers d’hébergement : hébergent les travailleureuses handicapéEs employéEs en ESAT.
- Foyers de vie ou foyers occupationnels : accueillent des personnes handicapées ne pouvant pas travailler mais disposant d’une certaine autonomie.
- Foyers d’accueil médicalisé (FAM) : accueillent les personnes nécessitant une assistance pour les actes de la vie quotidienne et une surveillance médicale régulière.
- Maisons d’accueil spécialisées (MAS) : destinées aux personnes lourdement handicapées nécessitant des soins constants.
- Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) : proposent un accompagnement pour favoriser l’autonomie à domicile et l’insertion sociale.
Toujours à fin 2018, 311 700 adultes étaient accompagnéEs dans ces structures, soit 0,6 % de la population adulte en France.
Malgré les rappels de l’ONU à la France sur la nécessité d’une politique vers la vie autonome, ces lieux de privation de liberté sont largement répandus encore aujourd’hui. Entre 2006 et 2018, le secteur médico-social a connu une croissance notable avec la création de 2 150 nouvelles structures, dont 740 services tels que les SAVS et SAMSAH. Cette expansion s’est traduite par la création de 77 300 places supplémentaires, réparties à 40 % dans les services et à 60 % dans les établissements.
Éliane Corbet, docteure en psychopédagogie, définit les « violences institutionnelles » comme « celles que subissent les usagers dans les institutions spécialisées, sociales et médico-sociales. » Ces violences peuvent être exercées par les personnes qui travaillent dans ces institutions, comme par celles et ceux qui y vivent. Selon Eliane Courbet, il faut « admettre que toute institution, sans une vigilance constante pour combattre les tendances lourdes qui l’animent […] est une institution à risque de violence. »[2]CORBET, Eliane, Coordinateur ; TOMKIEWICZ, Stanislaw, Auteur ; KLAJNBERG, Marcel, Auteur ; et al. Violences en institutions : 1. Repères = Journée d’étude : Lyon: 21 mars 1991. Lyon : Media … Continue reading
Formes de violences institutionnelles :
- Violences par action : comprennent des actes tels que les violences physiques, psychologiques ou sexuels commis par le personnel ou d’autres résidentEs.
- Violences validistes : incluent la négligence, le manque de soins appropriés, l’absence de réponse aux besoins fondamentaux ou le non-respect des droits des personnes accueillies.
Causes potentielles :
- Carences organisationnelles : manque de personnel formé, surcharge de travail, insuffisance de ressources ou de supervision, pouvant mener à des situations de stress et de burn-out chez les personnes travaillant dans les institutions.
- Système institutionnel : règlements internes trop stricts ou inadaptés, absence de liberté, ségrégation.
- Culture institutionnelle : normes et valeurs internes banalisant ou minimisant les comportements violents, ou décourageant le signalement de tels actes.
Conséquences pour les victimes :
Les personnes subissant des violences institutionnelles peuvent voir leur santé physique et mentale se détériorer, ainsi que leur vulnérabilité s’aggraver.
Les adultes et les enfants handicapéEs vivant en institution sont surexposéEs aux violences sexistes et sexuelles
En 2020, la Drees indiquait que 29 % des violences sexuelles à l’encontre des personnes handicapées enregistrées par les forces de sécurité se produisaient en établissement.[3]Média Social, « Handicap : lever le tabou des violences sexuelles en établissement », 14/03/2024 Les enfants sont aussi largement exposéEs.
Dans le monde, entre 5 et 6 millions d’enfants vivent en institution. Dans les 27 pays de l’Union européenne, ce sont plus de 300 000 enfants qui vivent en établissement médico-social. Malgré la fermeture progressive des grandes institutions de certains pays européens, les enfants handicapéEs sont transféréEs depuis de grandes institutions vers de plus petits foyers, de type familial ou villages d’enfants.[4]Blog des Dévalideuses, « Vie autonome des enfants et jeunes »
La Ciivise, Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, consacre une partie de son rapport aux enfants en situation de handicap. Selon ce dernier, les institutions sont le premier lieu d’agressions sexistes et sexuelles : « 36 % des viols sur mineur en situation de handicap enregistrés par les services de sécurité ont eu lieu au sein d’un établissement (IME, ESAT, hôpitaux), dont 35 % en IME ». Le domicile quant à lui est le lieu de 27 % des agressions. Ces enfants courent également plus souvent le risque d’être la proie de plusieurs agresseurs, et les agressions durent globalement plus longtemps.
Les victimes ne sont pas crues en institution, encore moins qu’ailleurs
En institution, la parole des personnes handicapées est encore plus rarement prise en compte, en particulier lorsque les victimes sont en situation de handicap mental.
Le 15 octobre dernier, le quotidien régional La Provence[5]La Provence, « Accusé de viols sur des handicapées, un kiné de Vence rejugé dans les Bouches-du-Rhône », 15/10/24 relatait qu’Olivier Benham, un kinésithérapeute de 38 ans travaillant au sein d’un foyer accueillant des personnes en situation de handicap physique et/ou mental, a agressé sexuellement et violé au moins quatre personnes au sein de cette institution. Pourtant, en dépit des traces de sperme recueillies par les enquêteurs, la parole de ces victimes ne semble pas être entendue puisque l’agresseur présumé continue de contester les faits qui lui sont reprochés. Pire encore, le quotidien rapporte qu’Olivier Benham serait positivement perçu par ses collègues, tandis que les victimes « sont décrites par la majorité du personnel du foyer comme “peu fiables”, “menteuses”, “influençables”, voire “aguicheuses” ». Lors du procès en appel, l’avocate générale a souligné que Behnam avait ciblé « quatre femmes fragiles avec l’espoir qu’elles ne parleraient pas ou qu’on ne les croirait pas ».[6]Nice Matin – Accusé de viols et agressions sexuelles sur des handicapées: peine aggravée pour un kiné de Vence
Ce dernier a été condamné en appel à 17 ans de réclusion criminelle.
Cette situation est emblématique des difficultés des victimes à se faire entendre, d’autant plus en institution. Il faut garder à l’esprit que selon l’Organisation Mondiale de la Santé, moins de 5 % des situations de maltraitance font l’objet d’un signalement.[7]ASH – Personnes âgées ou handicapées : hausse de 40% des alertes pour maltraitances au 3977
Pour Corbet, les personnes en situation de handicap mental seraient d’autant plus vulnérables qu’elles porteraient la forme de « défaillance » « la plus inacceptable aux yeux de la société : celle de la raison. » Ce risque serait accru si la personne se trouve dans l’incapacité de s’exprimer, de présenter des preuves ou de discerner ou non si elle est victime de maltraitances.[8]Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence, tome 1, Rapport n° 339 (2002-2003), tome I, déposé le 10 juin 2003
Les agresseurs sont bien plus souvent les soignantEs que les autres personnes résidentes
C’est un pilier fondamental à comprendre : les violences subies par les personnes handicapées dans les institutions sont bien plus largement le fait des soignantEs que des autres personnes handicapées. Cela va à l’encontre des stéréotypes validistes et psychophobes qui voudraient que « handicapéE » soit synonyme de « violentE ».
Pourtant, d’après le rapport de la Haute Autorité de santé sur la dangerosité psychiatrique[9]Haute Autorité de santé, « Dangerosité psychiatrique : repérer les signes d’alerte pour prévenir les actes de violence », 07/07/2011, il existe une « surestimation manifeste du risque de comportement violent chez les personnes souffrant de troubles mentaux. » Seulement 3 à 5 % des actes violents seraient dus à des personnes souffrant de tels troubles et ces personnes sont plus souvent victimes qu’agresseurs. Par ailleurs, le corporatisme du personnel soignant aggrave encore les VSS en institution : les personnes qui y travaillent se protègent mutuellement, compliquant ainsi l’accès des victimes à la justice.
La structure même des institutions permet, et pérennise, les violences sexistes et sexuelles
Vivre en institution entraîne une expérience de son corps et de son intimité qui brouille les limites de ce qui est acceptable. Les enfants en situation de handicap sont donc moins protégéEs, mais aussi moins outilléEs pour identifier les agressions : « Habitués à être déshabillés, lavés, manipulés, déplacés par plusieurs professionnels, ils ont d’autant plus de mal à distinguer les gestes légitimes des soignants de ceux relevant de la violence sexuelle », explique la Ciivise.
On peut faire le rapprochement entre les institutions qui accueillent des personnes handicapées et les institutions qui accueillent les personnes vieillissantes, car la mécanique est la même : la première catégorie d’agresseurs est le personnel soignant, les victimes sont peu crues et ultra-vulnérables. La justice n’est donc que très rarement rendue et le problème n’est pas pris en charge.
En 2022, Médiapart publiait une enquête sur les violences sexistes et sexuelles en Ehpad. On pouvait y lire: « En France, des dizaines de résidentes ont été agressées ou violées au sein des maisons de retraite. Mediapart a enquêté pendant plusieurs mois sur une réalité sous-estimée et méconnue. Le nombre des victimes pourrait être “monstrueux”, d’après le ministère des solidarités. »[10]Médiapart, « Violences sexuelles : en Ehpad, les femmes vulnérables sont des proies », 19/12/2022
Le silence statistique : un obstacle à l’action
L’un des plus grands obstacles à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en institution est l’absence criante de données et d’études spécifiques sur le sujet. Il est impossible d’agir efficacement contre ce qui n’est ni identifié, ni quantifié. Les rares chiffres existants, issus d’enquêtes partielles et d’observations de terrain, suggèrent pourtant une surexposition aux violences des personnes handicapées vivant en institution. Mais cette réalité reste invisibilisée par le manque de recherches approfondies et de recensements systématiques. Ce silence statistique n’est pas neutre : il traduit un refus institutionnel et politique de reconnaître l’ampleur du problème et de mettre en place des dispositifs adaptés. En occultant ces violences, on empêche leur prise en charge, et on condamne les victimes à l’isolement et au déni. La lutte contre les violences institutionnelles passe donc par une exigence première : briser l’omerta des chiffres et documenter ces réalités pour qu’elles cessent d’être niées.
Pour lutter contre les VSS en institution, la désinstitutionnalisation[11]Blog des Dévalideuses – La désinstitutionnalisation, c’est quoi ? est nécessaire
Nous, militantEs antivalidistes, estimons qu’il faut mettre la désinstitutionnalisation en œuvre afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles en institution.
Le principe des institutions repose sur une vision paternaliste de la personne handicapée. Cette idéologie, associée aux conditions matérielles de l’institution, requiert la passivité dans la prise de décision de la personne institutionnalisée. Il est nécessaire pour l’institution, telle qu’elle est fondée, que la personne soit « coopérante » : la priorité revient à l’adaptation de la personne à la structure, ce qui se place en opposition à la prise en compte réelle des besoins de cette personne et de ses moyens d’expression. Cette adaptation est nécessaire au fonctionnement le plus facile de la structure, sans que celle-ci ne se remette en question.
L’idéologie selon laquelle le handicap réside dans le « manque de capacité » pousse à voir des différences ou difficultés de communication. Ainsi, ne pas pouvoir penser de manière « normale », sans assistance, est perçu comme un frein naturel à la capacité à décider de sa vie, qui nécessite une prise de décision « à la place de ». Le rôle que se donne l’institution est donc de « guider », « protéger » et « aider à comprendre la situation ». Ce cadre qui juge la personne comme « vulnérable en elle-même » ne remet pas en question l’environnement comme vecteur de difficultés. Il ne présuppose pas non plus que le rôle des aides face au handicap est de permettre l’autonomie de décision de la personne quant à sa vie et aux aides dont elle a besoin pour permettre cette autonomie de décision.
Ainsi, si une personne concernée se dresse contre l’institution, elle est est vue comme récalcitrante et est punie indirectement, cela étant considéré comme « pour son bien ». On apprend aux personnes à respecter les règles et à devenir indépendantes pour certaines tâches qui ne sont pas importantes pour elles, mais qui permettent de réduire l’assistance à apporter (faire son lit, par exemple). L’objectif n’est donc pas d’aider la personne, en l’assistant et en adaptant son environnement, à exprimer ses besoins et à avoir un impact sur son environnement et sur sa vie. Cet aspect est supprimé, dans les institutions particulièrement, mais de manière globale, pour chaque personne perçue comme vulnérable par notre société. Plutôt que donner les moyens d’avoir un pouvoir de décision et d’action sur sa vie, on suppose que cela n’est pas atteignable et ce discours devient performatif. En effet, les aides pour être autonome dans la direction de sa vie (assistance à la décision vraiment dirigée par la personne concernée et assistance personnelle gérée par la personne concernée et ses personnes de confiance) ne sont pas accordées, car la personne est immédiatement perçue comme étant non capable.
L’institution fermée s’inscrit dans un système qui considère qu’une personne handicapée ne pouvant pas être autonome sans assistance (dirigée par elle et à son service, et non pas directrice de ses priorités) pour des raisons cognitives et psychiques, par exemple, ne peut intrinsèquement pas être autonome (avec assistance) quant aux décisions qui concernent sa vie et doit être protégée de ses décisions, pour son bien. L’institution lui en refuse alors les moyens et crée un cadre supposant cette impossibilité, présumant que la personne n’a rien de pertinent à penser sur sa situation et qu’il faut lui expliquer quoi penser et ce qui est bon pour elle.
En raison de cette vision binaire et naturalisante du handicap, les personnes handicapées sont poussées vers les institutions au moyen d’un tri selon deux catégories : « handicapéEs pouvant et devant travailler à leur rétablissement et autonomie », à qui l’on donne très peu d’assistance, et personnes « définitivement incapables et à protéger », que l’on oriente vers les institutions.
Ceci n’est pas la réalité du handicap, mais en ne recevant pas d’aide à l’autonomie, les personnes s’épuisent à tenter de réussir par elles-mêmes pour finir en institution. Ou bien, dès le début de leur vie, elles sont éduquées à croire que celles et ceux qui leur disent que faire le font forcément pour leur bien et sont plus capables qu’elles-mêmes de savoir ce qui est bon pour elles, ce qui les empêche de se faire confiance et les amène à ne plus exprimer leurs besoins, car leur expression n’est pas prise en compte et n’a pas d’impact sur la situation, voire est réprimée. Si les personnes handicapées ont le malheur de réussir malgré cela à s’exprimer, la structure n’est pas construite pour penser l’expression des personnes institutionnalisées comme quelque chose de positif, voire même normal. On va donc vouloir « calmer » cette expression et la pathologiser, tout en rationalisant l’impossibilité de l’entendre.
Pistes concrètes d’action :
- Les personnes handicapées étant éloignées des espaces médiatique et public, d’autant plus lorsqu’elles sont institutionnalisées, relayez leur parole quand elles la prennent.
- Posez-vous la question de vos privilèges et de vos pouvoirs : comment pouvez-vous rendre les espaces plus accessibles et comment pouvez vous donner la parole aux personnes concernées ?
- L’un des gros problèmes est l’omerta pesant sur des faits généralisés de violences : quand vous avez vent de violences en institution, dénoncez-les. Posez des questions si vous avez des proches en institution également.
- Si vous êtes concernéE par le handicap, renseignez vous sur ce que c’est l’institutionnalisation et ses dégâts, et cherchez des alternatives pour mettre en place la vie autonome. Par exemple, l’ENIL, cherchez les personnes proposant de la pair-aidance pour la vie autonome.
- Si vous êtes professionnellEs de santé : posez vous la question de comment vous pourriez accompagner différemment les personnes handicapées. Soyez conscientE qu’en dépit de toute la bonne volonté du monde, vous êtes empreintEs des biais validistes.
- Formez vous à l’antivalidisme pour déconstruire vos conditionnements.
Renverser le système, protéger les vies
Les violences sexistes et sexuelles en institution ne sont ni un accident, ni une fatalité : elles sont le produit d’un système qui infantilise, enferme et rend invisibles les personnes handicapées. Tant que l’institutionnalisation sera la réponse par défaut au handicap, tant que les personnes concernées ne seront pas maîtresses de leur propre vie, ces violences continueront. Il ne suffit pas de « réformer » ou d’ajouter quelques protocoles de protection : c’est l’ensemble du système institutionnel qu’il faut déconstruire. Nous exigeons la mise en place immédiate de politiques de désinstitutionnalisation, un accès effectif à la vie autonome et la reconnaissance des violences subies par les personnes handicapées. Il est urgent que la société cesse de détourner le regard et prenne enfin ses responsabilités. Combattre ces violences, c’est reconnaître que la liberté et l’autonomie des personnes handicapées ne sont pas négociables. Nous ne nous contenterons pas de demi-mesures : nous exigeons la justice, la sécurité et l’émancipation pour toustes.
References